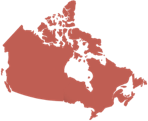Une réunion d’experts en ligne organisée par le Bureau des affaires publiques de la communauté bahá’íe du Canada a rassemblé plus de 100 personnes, dont des parlementaires, des universitaires, des fonctionnaires et des représentants de la société civile, qui ont discuté longuement de « L’intersection de l’oppression : les droits des femmes et la liberté religieuse en Iran » le 15 mai 2025. En présence de quatre spécialistes des droits de la personne, le webinaire a examiné comment les formes actuelles de discrimination envers les minorités en Iran en raison de leur genre et de leur religion se combinent pour intensifier la répression des femmes bahá’íes. Les intervenants ont mis en évidence les conséquences de cette double oppression et ont proposé des recommandations politiques aux gouvernements, aux organisations internationales et à la société civile afin qu’ils puissent réagir efficacement à ces violations des droits de la personne.

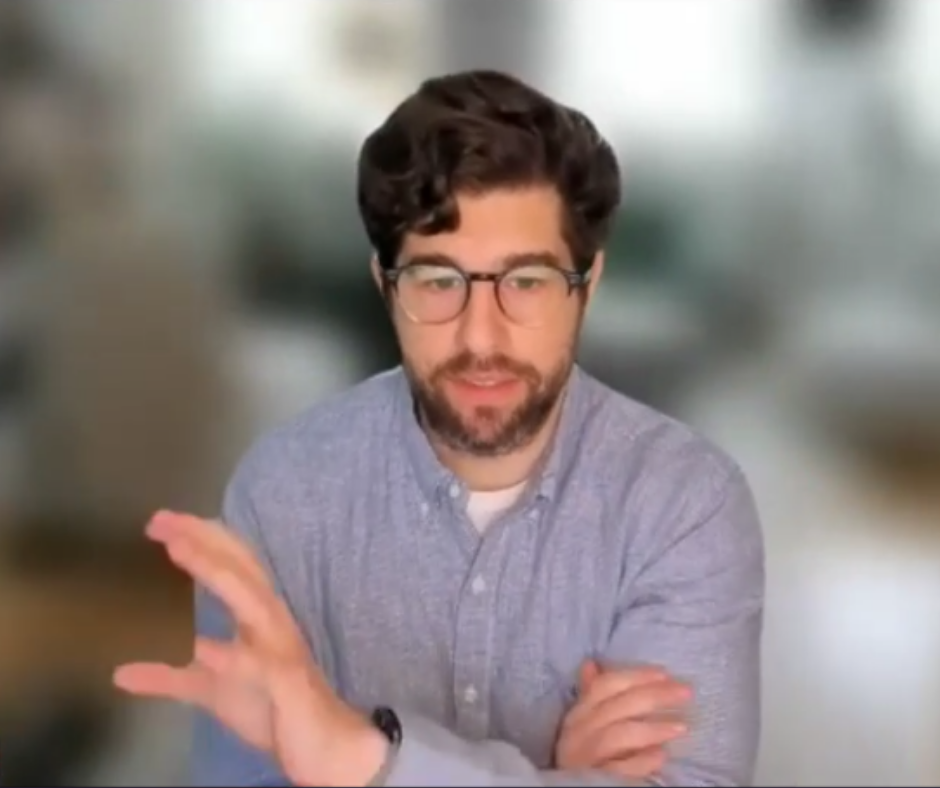


Dr. Fernand de Varennes, Rapporteur spécial sortant des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, a évoqué la nature systémique de la discrimination à laquelle font face les femmes appartenant à des minorités. « Les femmes appartenant à des minorités font face à une double exclusion en raison des politiques de l’État qui perpétuent des discriminations systématiques et qui sont enracinées dans les institutions gouvernementales », a-t-il affirmé. Il a souligné que les femmes bahá’íes et les membres d’autres minorités religieuses sont particulièrement vulnérables. De Varennes a cité une déclaration de décembre 2024 signée par 18 rapporteurs spéciaux et experts indépendants des Nations unies, qui s’inquiétaient du nombre grandissant de femmes bahá’íes incarcérées en Iran, soit les deux tiers de tous les prisonniers bahá’ís dans ce pays.
Elham Seddigh Ayafor, directrice des relations gouvernementales pour la communauté bahá’íe du Canada, a attiré l’attention sur les « systèmes de discrimination à plusieurs niveaux » auxquels les femmes bahá’íes font face en Iran. Le genre et l’identité religieuse s’y entrecroisent pour créer une réalité répressive unique. « Les femmes bahá’íes qui servent, maternent et élèvent les autres commettent un crime, » a-t-elle affirmé, expliquant que les femmes sont punies non pas parce qu’elles ont enfreint la loi, mais parce qu’elles ont tenté de contribuer à la société. Elle a décrit un modèle de persécution étatique en citant des exemples de femmes emprisonnées pour avoir enseigné à des enfants réfugiés ou simplement pour avoir observé leur foi. Ce modèle inclut le refus de l’éducation, l’exclusion de l’emploi et la déstabilisation de familles entières par des arrestations arbitraires, la surveillance, le harcèlement et la pression psychologique. « Être une femme et une bahá’íe en Iran est synonyme d’être une cible et d’être punie non pas pour ses actions, mais pour ce que l’on est », a-t-elle affirmé.
Directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Human Rights Watch (HRW), Michael Page, a présenté les conclusions du rapport 2024 de HRW, « Boot on My Neck: Iranian Authorities’ Crime of Persecution Against Bahá’ís in Iran » [Des bottes sur mon cou : Le crime de persécution des autorités iraniennes contre les bahá’ís en Iran]. « Le gouvernement iranien a clairement exprimé son intention de bloquer la participation et le progrès des bahá’ís », a affirmé Page, en soulignant que l’État recourait à des arrestations arbitraires, à un refus d’éducation et à une exclusion économique dans le cadre d’une campagne systématique de répression. Page a présenté la conclusion du rapport qui donne à réfléchir et selon laquelle la manière dont l’Iran traite les bahá’ís constitue un crime contre l’humanité, une forme de persécution en droit international.
Nazanin Afshin-Jam, défenseure des droits de la personne et cofondatrice de Stop Child Executions, a décrit l’Iran comme un pays fonctionnant selon un système d’«apartheid des genres et de religion ». Elle a utilisé des exemples historiques et actuels pour montrer comment les droits des femmes et des minorités religieuses sont non seulement érodés, mais aussi systématiquement niés. «En Iran, les femmes sont emprisonnées, torturées et parfois tuées pour avoir laissé une mèche de cheveux dépasser de leur voile. Elles sont considérées comme inférieures aux hommes selon la loi, leur témoignage n’a que la moitié de la valeur de celui d’un homme et elles ont besoin d’une autorisation pour voyager, travailler et même faire du vélo. » La discrimination envers les bahá’ís et les autres minorités religieuses est tout aussi profonde : on leur refuse l’éducation, l’emploi et même le droit à une sépulture décente. Afshin-Jam a mis en évidence que ce système d’exclusion à double volet n’est pas seulement le résultat de préjugés sociaux : « Il est systématique, légal et appliqué par une multitude d’institutions – tribunaux, universités, police religieuse, médias – qui ont pour mission de vous maintenir à votre place. »
Les experts ont également proposé des mesures politiques que le gouvernement canadien pourrait prendre en réponse à la dégradation de la situation des droits de la personne en Iran. De Varennes a mis l’accent sur le fait que le Canada peut et doit faire davantage sur la scène internationale pour défendre l’architecture mondiale de la paix, de la tolérance, de la justice et des droits de l’homme pour tous. Il a suggéré la constitution d’un comité d’experts canadiens spécialisé dans les droits des minorités, la mise en place de débats parlementaires réguliers sur les sujets concernant les femmes, la liberté de religion en Iran, ainsi que la collaboration internationale sur les récents dispositifs juridiques pour défendre les femmes issues de minorités. Il a également encouragé le Canada à prendre l’initiative aux Nations unies en proposant l’élaboration d’un traité sur les droits des minorités et en créant un nouveau poste de rapporteur spécial des Nations unies sur les crimes d’atrocité. Cela permettrait de « sensibiliser et d’attirer l’attention sur cette question aux Nations unies en attendant la conclusion d’un traité ».
Afshin-Jam et Page ont mis l’accent sur le rôle que jouent les sanctions ciblées en matière de droits de la personne comme outil de responsabilisation. Ils ont demandé que des mesures soient prises pour identifier et punir les individus et les institutions responsables de la poursuite des politiques répressives, notamment celles qui ont mené à la confiscation des biens et aux arrestations massives. « L’application de la loi est la priorité absolue », a affirmé Afshin-Jam, qui a plaidé en faveur d’une formation spécialisée pour les fonctionnaires chargés des frontières et de l’immigration au Canada. Ces agents pourraient ainsi détecter les violations des droits de la personne et prendre les mesures appropriées.
Le panel a également appelé à une augmentation des voies d’accès au statut de réfugié pour les bahá’ís et les autres groupes vulnérables fuyant la persécution en Iran. De Varennes a suggéré que les bahá’ís iraniens soient considérés d’emblée comme des personnes persécutées pouvant prétendre au statut de réfugiées et à la réinstallation. Quant à Afshin-Jam, elle a demandé au Canada d’élargir son programme « Protégeons les défenseurs » et d’accroître son appui aux initiatives de la société civile, tant en Iran qu’en exil.
En conclusion, Seddigh Ayafor a souligné que la question de la persécution des bahá’ís en Iran devrait être considérée comme faisant partie du mouvement global en faveur de l’égalité des genres et de la transformation sociale dans le pays. « Il ne s’agit pas seulement de l’histoire d’une souffrance », a-t-elle déclaré, « c’est l’histoire d’un sacrifice, d’une résilience et d’une vision de l’Iran dans laquelle toutes les personnes, indépendamment de leur foi, de leur origine ou de leur genre, peuvent vivre dans la dignité et prospérer ensemble ». Elle a ensuite déclaré : « Les femmes bahá’íes iraniennes travaillent main dans la main avec leurs compatriotes pour améliorer la société. Nous, au Canada, devons aussi agir. Il faut qu’on soit leur voix et qu’on s’assure que l’Iran ne puisse pas agir en toute impunité. »
Pour écouter l’intégralité de la discussion, cliquez sur ce lien.